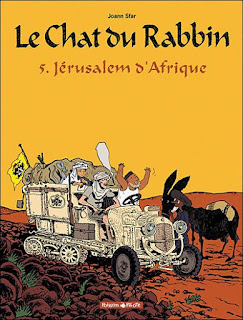The Kempton-Wace letters
 "La Correspondance Kempton-Wace" porte en français un titre très cucu. Rien à voir pourtant avec la Quinzaine du Q : on ne parle ici que grandes émotions et petites raisons. On ? Qui ça on ? Eh bien Jack LONDON et Anna STRUNSKY, voyons !
"La Correspondance Kempton-Wace" porte en français un titre très cucu. Rien à voir pourtant avec la Quinzaine du Q : on ne parle ici que grandes émotions et petites raisons. On ? Qui ça on ? Eh bien Jack LONDON et Anna STRUNSKY, voyons !
Reprenons : en 1903 paraît anonymement un roman épistolaire portant sur la philosophie de l'amour. Jack London a écrit les lettres de Dane Kempton, jeune lion matérialiste chargé de cours en sociologie à San Francisco ; Anna Strunsky a composé celles de Herbert Wace, père symbolique de Dane, poète des beaux sentiments qui vit à Londres.
Dane vient de trouver femme à sa pointure : Hester, une intellectuelle qu'il aime pour son intellect ; et aussi parce qu'elle incarne la femme-mère. Ecrivant la première lettre à son vieux professeur sous ce prétexte, Dane se trouve rapidement contraint de répondre aux questions pressantes de Herbert sur les circonstances de cette histoire amoureuse. Amour ? Amour ?! Beurk, cette convention artificielle inventée par la civilisation pour arranger la réalité ? Cet oripeau qui nous distrait de la fonction purement utilitaire de toute manifestation sexuelle ? Eh bien quoi, convenez qu'on ne baise que pour perpétuer l'espèce, c'est prouvé scientifiquement et testé dermatologiquement.
... Non ?
C'est en tout cas en substance le point de vue que défend Dane Kempton en face du père poète dont il cherche à sacrifier les vieux idéaux amoureux sur l'autel de la modernité. Mais contre toute attente, et malgré son côté souvent plonplon, l'amour à papa n'est pas mort : il bouge encore. Et Herbert confronte Dane aux souvenirs de ses amours d'adolescent :
« Tes amours ! Comme tu les a bien laissées derrière toi et avec quelle aisance tu les critiques ! Elles n'ont pas résisté à l'épreuve du temps, car tu ne leur accordes aucune fidélité. Tu les qualifies (...) de caprices d'adolescent... Tu ne leur témoignes guère de respect ! Pour cette raison, tes exemples perdent le poids qu'ils auraient pu avoir. Ils appartiennent à un passé révolu et ne sont plus que des fantômes d'émotions défuntes ; ils ne peuvent te faire connaître l'amour. Si ces cendres sont aujourd'hui froides, à quoi t'a-t-il servi de prendre feu naguère ? Tu ne peux rien apprendre de ce qui est totalement fini. »
Qui sait même si Hester, lasse d'être l'objet d'un amour rationnel et réfléchi, le résultat d'une sélection naturelle, ne va pas se rebeller à la toute fin de cet échange ?
Elle va se gêner, tiens !
225 pages, coll. Phébus libretto - 12,50 €